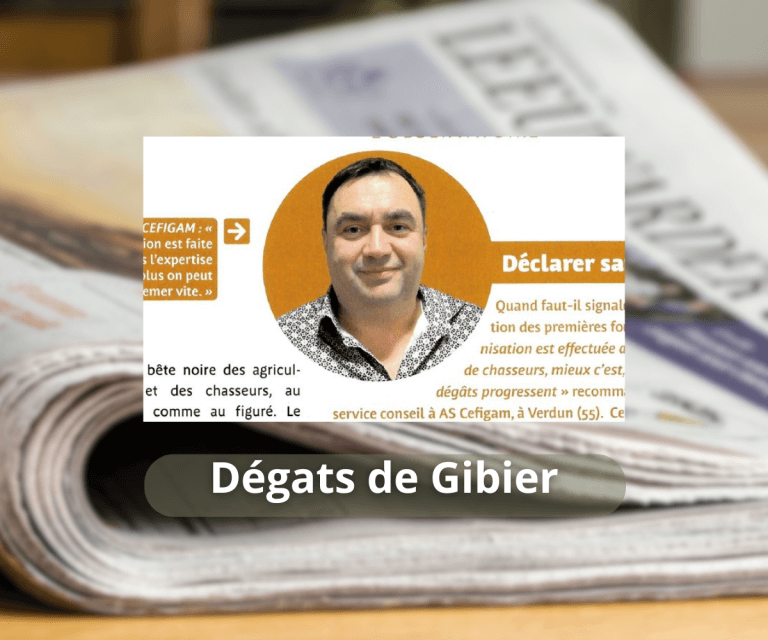À l’heure où les exploitations agricoles clôturent les récoltes estivales et se projettent vers les semis d’hiver, une menace reste omniprésente : les dégâts causés par la faune sauvage, dont les sangliers.
Pour explorer le sujet, le site Perspectives Agricoles a donné la parole à Accompagnement Stratégie dans une interview sur le thème des dégâts de gibier, qui peuvent toucher des exploitants agricoles. Découvrez les suggestions du Conseiller AS, recommandations à connaitre en amont ou à suivre, si cela vous arrive.
Faire face aux dégâts de gibier :
Un dossier alimenté par l’expertise de Patrice Jung, Responsable du service Conseil de l’AS CEFIGAM, basé à Verdun, ainsi que l’interview de Matthieu Salvaudon, de la FNC (Fédération Nationale des Chasseurs).
L’AS CEFIGAM est une AGC, Association de Gestion et Comptabilité (association loi de 1901) de la Meuse, basée à Verdun et Bar-Le-Duc. Ses antennes accompagnent plus de 900 entreprises de tous les secteurs. Les adhérents sont des artisans, commerçants, professions libérales, prestataires de services et bien sûr agriculteurs. L’AS CEFIGAM regroupe une quarantaine de collaborateurs pour accompagner au quotidien les adhérents sur du conseil, de la gestion et de la comptabilité.
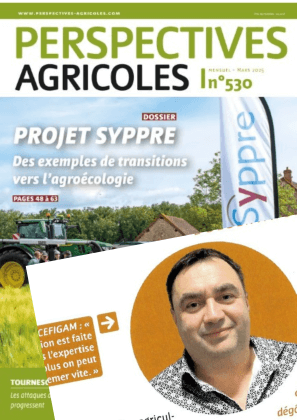
Perspectives Agricoles est un magazine mensuel réalisé avec l’appui des instituts techniques de grandes cultures. Référence en matière d’agronomie et d’innovation, il s’adresse aux agriculteurs et agricultrices férus de technique et d’expérimentation.
Les sangliers, autrefois cantonnés aux forêts, occupent désormais les plaines agricoles presque toute l’année fragilisant l’organisation des campagnes agricoles. Comment faire face à ce phénomène ?
1. Quelle est l’évolution du phénomène des dégâts de gibier ?
On constate des dégâts de plus en plus nombreux et impactants comme l’attestent des chiffres récents : sur la campagne 2022-2023, c’est plus de 90 millions d’euros qui ont été dépensés en termes de facture globale pour des dégâts de gibier.
Les fédérations départementales de chasse, qui indemnisent les exploitants agricoles, voient leurs finances lourdement impactées, alors même que le nombre de chasseurs baisse (environ -2 % par an).
Face à la prolifération des sangliers, on peut se questionner sur les facteurs qui accentuent cette tendance croissante; parmi eux on peut noter :
Un climat plus doux
Les hivers moins rigoureux réduisent la mortalité des marcassins; les conditions sont de plus en plus favorables pour leur survie.
Une reproduction rapide
Une laie peut mettre bas trois fois tous les deux ans, ce qui accélère la croissance des populations.
L’importance des zones non chassables
Près de 30 % du territoire métropolitain n’est pas chassable ou très peu chassé : zones urbaines, secteurs interdits, propriétés privées.
L’évolution des pratiques agricoles
Grandes parcelles, cultures fourragères, maïs, colza, couverts végétaux : tout cela offre nourriture et abris, même en dehors de la forêt.
2.Quelles sont les conséquences concrètes pour les agriculteurs ?
La fin de l’été et l’entrée dans l’automne réunissent plusieurs conditions propices aux dégâts causés par les sangliers. À cette période, les cultures encore présentes dans les champs constituent une ressource alimentaire particulièrement attractive. Les sols, encore souples après les pluies de fin d’été, facilitent par ailleurs les fouilles.
Tout concourt donc à maintenir les animaux à proximité des parcelles agricoles et à accroître les risques pour les exploitants !
C’est une période qui appelle à une extrême vigilance au regard des conséquences.
Les dégâts causés par les sangliers entraînent :
– Semis détruits → nécessité de ressemer rapidement.
– Rendements réduits, décalage des cycles culturels.
– Surcoûts importants : semences supplémentaires, main-d’œuvre, remise en état des sols.
– Impact sur l’assurance récolte : plus on attend pour réagir, plus la moyenne de rendement baisse, ce qui affaiblit la couverture assurance en cas d’aléas climatiques, c’est une conséquence dont il faut avoir conscience pour l’éviter !
L’attitude gagnante : être un exploitant averti « Déclarer dès les premières fouilles permet d’agir vite et de limiter les pertes » recommande Patrice Jung, Responsable du service Conseil de l’AS CEFIGAM.
Un dispositif d’indemnisation est en place, il faut le connaitre et avoir conscience des limites pour éviter des déconvenues.
✔️ Indemnisations pour les dégâts causés par sangliers et cervidés.
❌ Pas de couverture pour les dégâts du petit gibier (lapins, pigeons, etc.).
❌ Pas d’indemnisation pour les espèces protégées.
✔️ Seuil minimal d’ouverture de dossier : 150 € par an.
La négociation amiable est possible, mais souvent difficile à appliquer faute de preuves claires.

3. Que faire pour anticiper ou réagir au mieux ?
Quelques bonnes pratiques permettent de limiter l’ampleur des pertes.
Surveiller régulièrement les parcelles sensibles reste essentiel, tout comme signaler rapidement les premières traces de dégâts afin de déclencher une expertise et, si besoin, un ressemis. Agir vite demeure le meilleur moyen de préserver les rendements et d’éviter un décalage dans les cycles de culture, ce qui est capital. Surtout il ne faut pas attendre même si l’épisode n’est pas terminée « quitte à refaire une notification si les dégâts progressent » précise Patrice.
Même si la situation demeure préoccupante, les mesures engagées depuis 2023 commencent à produire des effets : allongement de la période de chasse dans certains départements, meilleure coopération entre les agriculteurs, chasseurs, services de l’état et résidents autour de l’exploitation ou des bois aux alentours.
De plus, l’utilisation d’outils modernes pour observer voire évaluer l’étendue des dégâts, apporte une autonomie nouvelle aux exploitations et permet des points d’alerte ainsi que des décisions plus rapides et plus précises.
En conclusion, pour les chefs d’exploitation, la clé réside dans cette approche cumulée ! Et avant tout, c’est un sens de l’anticipation qui fera la différence pour sécuriser les cultures et dissuader les animaux de revenir sur les parcelles.
Retrouvez dans le site internet Perspectives Agricoles l’intégralité de cette interview et + de contenu exclusif pour les abonnés (ou dans le magazine: édition de mars 2025, n°530).
Sources complémentaires :
Perspectives Agricoles n°530 : https://www.perspectives-agricoles.com/archives/projet-syppre-des-exemples-de-transitions-vers-lagroecologie
AS CEFIGAM : https://www.cefigam.com/
FNC : https://www.chasseurdefrance.com/
Photo : snapshot freddy – shutterstock.com